févr. 26, 2010
La barricade du cygne
Je ne me suis pas suicidée. L'eau a monté, monté. Et je me suis noyée. Maintenant je suis morte. J'ai des pétales dans les cheveux. Toute petite, déjà, j'aimais les fleurs. Je les mangeais dans le jardin. Mon grand-père me laissait faire. Il me disait : pas les jaunes. Les fleurs jaunes rendent malade. Elles tuent même quelquefois. En ce temps-là, j'aimais Martin. Il était plus vieux que moi. C'était le fils du boucher. Sa peau sentait la viande. Il était beau comme une fille. Il avait des cils de fille. Ses yeux étaient cruels. Il n'aimait pas son père. Il disait : un jour, le le saignerai. Comme un porc. Avec mon couteau préféré. Et je boirai son sang. Dans le jardin de mon grand-père, il y avait un arbre...
Hubert Haddad
15:40 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
févr. 10, 2010
La bête et la belle
...Personne ne se maria, personne n'eut beaucoup d'enfants. Le crapaud resta crapaud, aucune jeune fille ne s'étant proposer pour lui donner un baiser, en dépit de nombreuses annonces parues dans les revues spécialisées. Le petit poucet, perdu dans la jungle des villes, devint contremaitre chez Citroen. Les sept nains terminèrent leur vie dans un centre de gériatrie. Le petit canard de devint jamais gygne : il retourna au pays avec le million pour les immigrés. Le chat botté fut capturé par les rabatteurs d'un laboratoire pharmaceutique où l'on pratique la vivisection... Tout fout le camp...
Thierry Jonquet
11:58 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 22, 2010
Mains
Je me souviens de tes doigts sur la pierre. Il faisait presque nuit. C’était en Angleterre, nous faisions connaissance…Tu as touché le mur. J’ai regardé ta main s’enquérir et comprendre. Savoir. Une affaire de désir entre le monde et toi. Une question d’expertise. Une histoire d’entente et, voilà, je t’aimais.
Viviane Forestier
19:05 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 18, 2010
La bouche de quelqu'un
Chaque jour de nouvelles noisettes tombent.
Je ne marche plus pareil, je m’accroupis.
Le temps qui passe ne touche pas par terre. Moi si. Triant les fruits
des débris variés, ma solitude s’emplit de modestie. J’ai déjà été petite.
Le besoin qu’on a de se nourrir.
En réalité je n’ai pas faim, bien sûr.
Chaque noisette que je tiens, m’avançant tout bas, n’a pas
appartenu à un chapelet, même jeté et brisé. Tu me refuses ta présence
pour que j’apprenne à ne plus attendre. Je les ramasse sans me dépêcher,
me montrant à moi-même comment je t’aime aujourd’hui et peut-être
nous nous aimons. Le menton sur les genoux, j’oublie de vieillir. Je suis
attentive.
Il y a quelques jours tes soupirs pendant que je caressais les bouts
de tes seins, émotion pas si minuscule, très longue même. Entre tes
jambes, suite du paysage, tu bandais avec patience. Je vais encore
demander si c’est un poème, mais je ne demande plus si je t’aime.
Ariane Dreyfus
10:04 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
La crise commence où finit le langage
Aujourd'hui, la litanie de l'époque est éloquente.
« C'est la crise pour tout le monde. La crise financière secoue les économies. Elle modifie notre existence. Comment faire pour l'affronter ? Elle altère de deux points le moral des Français. Il va falloir adapter nos modes de vie. La fin de la crise n'est pas pour demain. Elle est pour demain. La crise de système est devenue une crise de confiance. »
Toutes ces phrases d'experts autoproclamés, que vous entendez dans les médias, ont pour point commun de ne spécifier aucun contexte. Je peux aussi bien remplacer le mot « crise » par le mot « dieu » ou par le mot « diable », une question demeure : avez-vous une quelconque prise sur la situation que désigne ce mot ? Si je reprends la dernière phrase, soit « La crise de système est devenue une crise de confiance », pouvez-vous vous projeter distinctement dans ce « système », et comprendre les liens réels qui le relient à votre existence ? Quant à cette « crise de confiance », elle n'est pas plus claire. Qu'est-ce que cet environnement glauque, sans localisation précise, où votre confiance serait en berne ? Enfin, qu'est-ce que cette conversion d'une raison systémique en raison psychologique ? Le manque de précision est évident. De quoi parle-t-on au juste? Ces mots ne font référence à aucun contexte. Ce sont des coquilles vides, qui planent très haut dans l'éther.
Mais personne ne relève ces carences. Dès le petit déjeuner, à la radio, ces phrases diffusent une angoisse sourde, qui vous retient de clarifier leur usage. Elles vous intimident et réduisent à néant votre potentiel critique face à ce qui apparaît comme un incommensurable et affligeant déterminisme. La crise existe comme les monstres sous les lits des enfants. Lorsque vous reprenez ensuite ces arguments pour les échanger dans des conversations ordinaires, vos propos intimidés deviennent à leur tour intimidants. Ils rendent illégitime la critique sociale, et subsidiaires les questions touchant essentiellement au vivre-ensemble. C'est ainsi que prend forme le consensus de crise : dans la prostration du langage. C'est ainsi que toute disposition individuelle à la vulnérabilité psychologique est travaillée au corps par le langage ordinaire, par ces mots qui n'ont l'air de rien.
À un degré plus hollywoodien encore, cette intimidation peut devenir un véritable instrument de communication, comme en attestent les récents propos d'un ministre :
« Je crois qu'il est très malvenu d'aller manifester dans la rue alors que nous sommes en pleine crise (...) il faudrait plutôt penser à se serrer les coudes. »
Cette phrase vous atteint en vous culpabilisant. Sa rhétorique de l'urgence vous fait percevoir que vous êtes, contre votre volonté, membre de l'environnement de la crise. Mais pour que cette perception soit optimale, elle doit rester imperméable au langage clarifié. Vous pourrez bien vous offusquer de ces propos, ils vous atteindront profondément. Ils vous intimideront et vous plongeront dans cette « nuit sans fin », inexprimable et inconcevable. Une fois de plus : où vos mots s'éteignent, la crise apparaît. Pourtant, avec un peu d'acuité, le message hollywoodien de ce ministre pourrait facilement être retourné dans quelle mesure l'illusion métaphysique d'un déterminisme affligeant nommé crise est réalisé et entretenu afin de vous empêcher de descendre dans la rue pour rappeler aux dirigeants de ce pays que vous n'êtes pas responsables de la crise et n'avez pas à en faire les frais ?
Vous n'êtes pas responsable de la crise et n'avez pas à en faire les frais. Soit, mais se dégager de cette responsabilité suppose désormais de parvenir à identifier les conditions de sa vulnérabilité au niveau individuel. Par-delà le clivage opposant l'angoisse vécue au quotidien et le divertissement qui la rend supportable, une alternative critique consiste à reprendre le cours de la conversation pour tenter de désigner la « nuit sans fin » qui vous terrifie. Déjouer l'illusion métaphysique du langage permet d'identifier les limites de la crise économique mondiale à l'échelle I. Les effets désastreux constatés dans la vie de chacun sont les fruits d'arrangements qui n'ont rien d'ésotérique. Ces dérives financières s'inscrivent dans des pratiques réelles qui prennent forme dans des lieux réels, comme ceux que fréquente le ministre cité plus haut : des salles de conseil d'administration de multinationales ou de banques, des conseils des ministres, des salles de réunion des grands de ce monde (Fonds Monétaire International, Banque mondiale, G20, etc.), des lieux plus informels dévolus à la réflexion ou à l'apprentissage de la gestion de crise, etc. De même, le mot « bourse » ne désigne pas un événement qui cause votre perte, mais un lieu identifiable sur une carte, un lieu où l'on spécule, avec des salles de conférences, de séminaires, des bars lounge où l'on parle clairement de l'état du monde. Ceux qui occupent de tels lieux succombent moins que vous à l'illusion métaphysique de la crise. L'intimidation y est plus rare, le langage n'y connaît pas de fin. Ceux-là savent que la crise n'est pas satellisée dans un ciel métaphysique, qu'elle n'est qu'une illusion résultant d'un consensus d'intimidation qui interdit d'investir pratiquement en mots et, par là, en actes, les lieux où se noue le théâtre des opérations.
Si, pour reprendre les mots de Claude Lévi-Strauss, « la crise est bonne à penser », il reste à définir le cadre et la démarche de cette réflexion. Laisser ce projet aux sciences économiques et aux sciences politiques revient à occuper un niveau hollywoodien qui contribue à entretenir l'illusion métaphysique. L'existence de chacun ne se renouvellera pas en profondeur sans une clarification régulière de l'usage qui est fait du langage ordinaire. Wittgenstein avait, en son temps, assigné ce projet à la philosophie - ce qui constitue sa profonde modernité. Cet accès à la raison anthropologique de la crise n'est pas la chasse gardée d'une élite de spécialistes. Elle est une discipline de vie, une lanterne pour avancer dans les marais de ce que les historiens et les politiciens nomment « civilisation ». Lorsque les mots seront clairement prononcés, le temps sera venu de ne plus se faire d'illusions.
Eric Chauvier
09:27 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 17, 2010
Les nourritures terrestres, insomnies
Il y a des nuits où l'on ne pouvait pas s'endormir. Il y avait de grandes attentes -des attentes on ne savait souvent pas de quoi- sur le lit où je cherchais en vain le sommeil, les membres fatigués et comme déjetés par l'amour. Et parfois je cherchais, par delà de la chair, comme une seconde volupté plus cachée.
...
Ma soif augmentait d'heure en heure à mesure que je buvais. A la fin elle devint si véhémente, que j'en aurais pleuré de désir.
...
Mes sens étaient usés jusqu'à la transparence, et quand je descendis au matin vers la ville, l'azur du ciel entra en moi.
...
Les dents horriblement agacées d'arracher les peaux de mes lèvres et comme toutes usées du bout. Et les tempes rentrées comme par une succion intérieure. L'odeur des champs d'oignons en fleurs, pour un rien m'aurait fait vomir.
André Gide
15:08 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 16, 2010
Souvenirs invivables
Il est des soirs où l’envie d’écrire vous prend comme une envie de femme. L’écriture est une activité tout aussi vaine que l’amour, sans doute, mais moins agréable, car les mots, dont il faut briser la petite coquille minérale, vous écorchent un peu en montant de la poitrine. On s’y fait pourtant, et lorsqu’on parvient à les épingler correctement sur quelque feuille, on en retire une curieuse satisfaction purement physique, qui n’exclut pas un relent d’inquiétude : et s’ils allaient bouger, se disperser, fuir ? On ne les connaît pas suffisamment, on les soupçonne de dissimuler quelque puissance sournoise qui leur permettrait de s’animer d’une vie propre et de s’ordonner selon des lois qui vous rendraient fou.
Henri Gougaud
19:09 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 15, 2010
Essai sur le lit
... Parmi tous les mots arabes qui disent le lit, j'aime celui de Sarir. Il renvoie à Sirr, secret ; à Sarira, l'intime et le profond ; à Sira, autobiographie ; à al-Isrâ, le voyage nocturne. C'est dans l'espace de tout ce condensé que mon corps, jamais, ne cessera de se consumer et d'abolir le hasard.
Maati Kabbal
11:24 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
Essai sur le lit
Jusqu'à une date récente, chez nous, on dormait encore par terre. On déployait des couvertures avant de se livrer, à même le sol aux rêves, à l'amour ou aux cauchemars. On était poussière, mais toujours près de la terre. La modestie des hommes provient peut-être de cette posture. Ces derniers ne deviennent-ils pas intraitables dès qu'ils se mettent debout ? "L'invention" du lit est donc chez nous de date récente...
Maati Kabbal
11:18 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
janv. 01, 2010
V(O)EUX
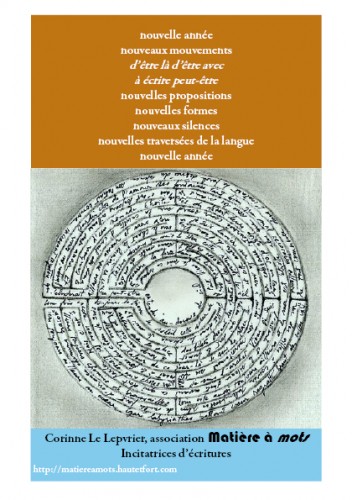
17:49 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
déc. 22, 2009
La petite fille aux allumettes
...La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi ; le flamme s'éteignit, le poêle disparut : elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à la main. Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, il devint tranparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fines porcelaines, et une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Ô surprise ! Ô bonheur ! Tout à coup l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille...L'allumette s'éteignit : elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée. Aussitôt la fillette se vit assise sous un magnifique arbre de Noël ; il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu, à la Noël dernière, à travers la porte vitrée, chez le riche marchand. Mille chandelles brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes les couleurs, semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains : l'allumette s'éteignit ; toutes les chandelles de Noël montaient, montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'était que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. "C'est quelqu'un qui meurt", se dit la petite...
Andersen
23:14 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
déc. 13, 2009
Souci
...Et quand vous enlevez l'autre peau, le sac qui vous sert de visage ils sont là les soucis. La trace de vous-même remorqué dans la vie par la peau du cou, raclé par les fesses ou cogné dans le mur. On enlève cette peau-là aussi, pour réfléchir un moment : on la tient devant soi, les yeux dans les yeux on se regarde. Qui tu es, toi, si on t'enlève ce que tu n'as pas choisi et qui s'écrit. Qu'est-ce qui te reste ?...
François Bon
11:15 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
déc. 03, 2009
Etranges étrangers
Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
hommes des pays loin
cobayes des colonies
Doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d'Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d'Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manoeuvres désoeuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordous soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
la liberté des autres
Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d'une petite mer
où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte à cigares
et quelques bouts de fil de fer
tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet
Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d'or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd'hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Etranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourrez.
Jacques Prévert
10:48 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier
déc. 01, 2009
...
Ce n'est pas que les hommes m'indiffèrent ; ils me dépassent sans cesse, ils vont trop vite ; ils vont avec leurs paroles accolées à leurs lèvres comme une bave volatile ; ils vont sans même cueillir leurs fruits éphémères, ils les couvrent seulement d'un suaire distrait.
Je n'ignore pas l'égale vanité de mes lenteurs, l'inimportance de ma présence et de ma disparition. C'est dans ce peu que je souhaite m'étendre, que je souhaite minutieusement reculer. C'est du côté de la colline que j'aime embrasser l'air, que j'aime composer avec la matière l'inutile infinitude du poème, la calme et négligeable traque de la diction des choses. C'est dans la chronique de ces instants qui ne peuvent que se taire et dont la langue quête l'exaspérée proximité, que j'espère l'alarme de la rupture et du baiser, son accablement, sa sérénité.
Nicolas Pesquès
09:01 Publié dans LITTERATURE / Anthologie de Corinne Le Lepvrier










































